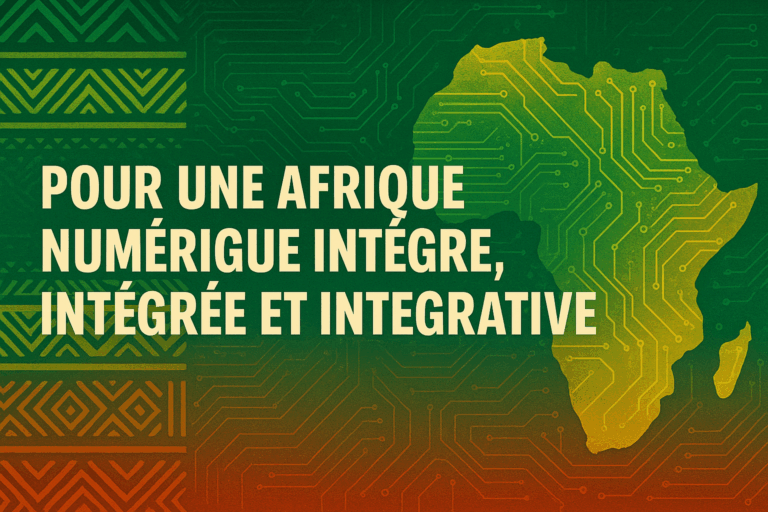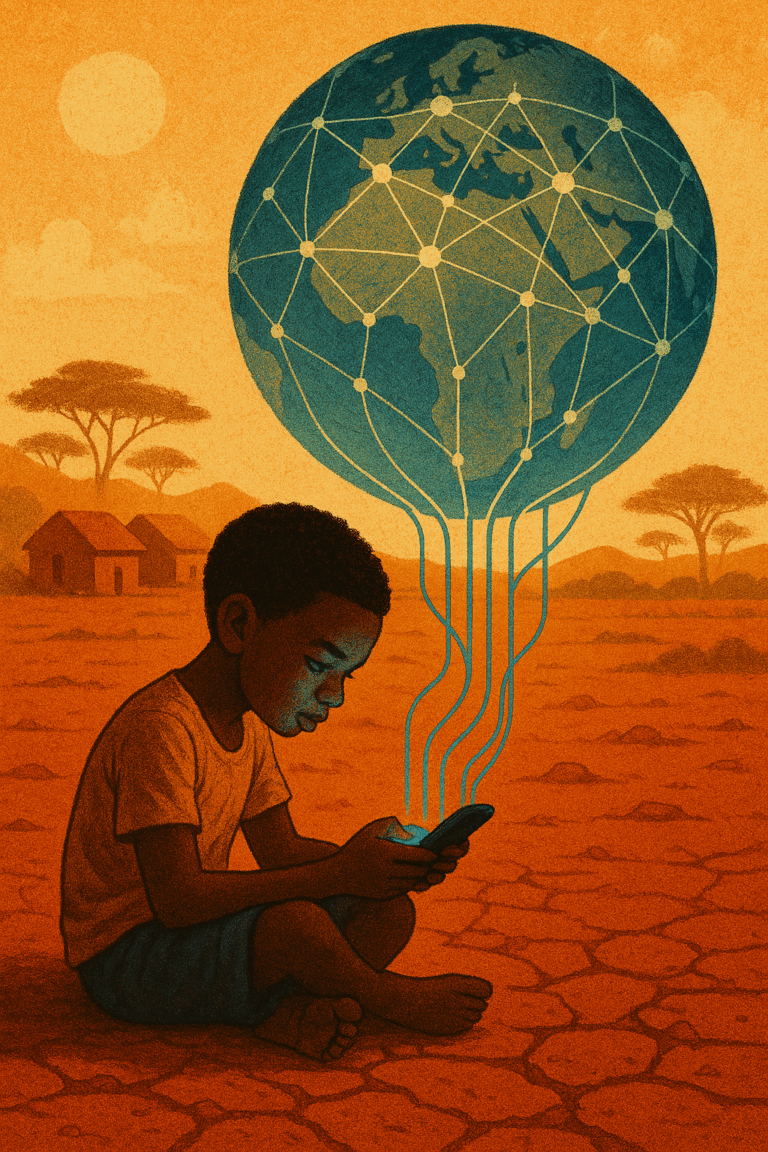Alerte sur la surexposition aux écrans des enfants en situation migratoire
Si les effets délétères des écrans sur les jeunes enfants font aujourd’hui consensus dans le débat public européen, un angle mort demeure : celui des enfants issus de familles migrantes. Des travaux émergents pointent une surexposition précoce, souvent liée à des contextes de grande précarité et à un défaut d’alternatives éducatives. Une problématique méconnue, mais urgente.
Dans un monde où les écrans s’imposent comme des compagnons de chaque instant, l’alerte sur leurs effets chez les enfants est désormais bien documentée. Troubles de l’attention, retard de langage, perturbations du sommeil : les conséquences d’une exposition excessive sont connues, débattues, et font l’objet de recommandations sanitaires en Europe. Pourtant, un angle mort persiste dans cette mobilisation : celui des enfants issus de familles migrantes, dont la surexposition précoce aux écrans constitue une problématique encore largement ignorée.
Les quelques études de terrain menées dans des contextes migratoires — en centres d’accueil, en hébergements d’urgence ou dans les quartiers populaires — montrent que les très jeunes enfants de familles primo-arrivantes sont exposés aux écrans, en particulier téléphones portables et téléviseurs, dès le plus jeune âge. Cet usage n’est pas anodin : il s’inscrit dans des contextes de vulnérabilité sociale, de désorientation culturelle et de précarité éducative.
Pour des parents déracinés, les écrans peuvent représenter un outil de médiation temporaire, un “répit” face à l’instabilité de la vie migratoire. Parfois, ils servent à occuper un enfant dans des espaces collectifs ou d’attente. Parfois aussi, ils permettent un lien avec le pays d’origine — par des dessins animés dans la langue maternelle ou des appels vidéo avec la famille restée au pays. Mais ce recours aux écrans masque une autre réalité : le manque d’alternatives éducatives, de soutien parental et d’accès à des structures d’accueil ou de scolarisation adaptées.
Or, l’impact des écrans est d’autant plus préoccupant qu’il s’exerce dans un vide relationnel ou langagier. Chez les enfants en situation migratoire, cette exposition intervient souvent dans des contextes où l’apprentissage de la langue, la socialisation et les repères affectifs sont déjà fragilisés. Cela peut renforcer des retards développementaux, notamment sur le plan cognitif et affectif, et compromettre l’intégration scolaire et sociale future.
Face à ce constat, il devient urgent de sortir de l’angle mort. Les politiques de santé publique et les acteurs de terrain doivent intégrer cette dimension dans leurs diagnostics et leurs actions. Il ne s’agit pas de stigmatiser les usages des familles, mais de mieux comprendre les réalités qui les sous-tendent, pour proposer des accompagnements adaptés : médiation culturelle, espaces de jeu sans écran, formation parentale, accès renforcé à la petite enfance.
Penser l’exposition aux écrans des enfants migrants, c’est aussi reconnaître que l’exil numérique n’est pas un refuge anodin. Et que, derrière les écrans, se jouent parfois des silences qui appellent à être écoutés.
Version courte PLEA de l’article
Plaidoyer – Enfants migrants et écrans : sortir de l’angle mort
L’exposition excessive des jeunes enfants aux écrans fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus scientifique. Mais une réalité reste sous-documentée : celle des très jeunes enfants en situation migratoire, souvent exposés très tôt et intensément à la télévision ou aux téléphones portables, dans des contextes marqués par l’exil, la précarité et l’isolement.
Pour les familles primo-arrivantes, les écrans peuvent apparaître comme un refuge temporaire, une manière d’occuper les enfants dans des espaces exigus ou instables, ou encore de maintenir un lien avec la culture d’origine. Mais en l’absence d’interactions langagières et sociales suffisantes, ces usages peuvent accentuer des retards de développement, particulièrement dans l’apprentissage de la langue et la socialisation.
Nous appelons les pouvoirs publics, les collectivités, les professionnels du social, de la santé et de l’éducation à intégrer cette problématique dans leurs diagnostics et leurs dispositifs d’accompagnement. Il est urgent de proposer des alternatives concrètes : lieux d’accueil sans écran, médiations parentales, formation interculturelle, accès anticipé à la petite enfance.
La question des écrans chez les enfants migrants n’est pas une exception marginale. Elle est un révélateur de fractures silencieuses, et un enjeu central d’inclusion.